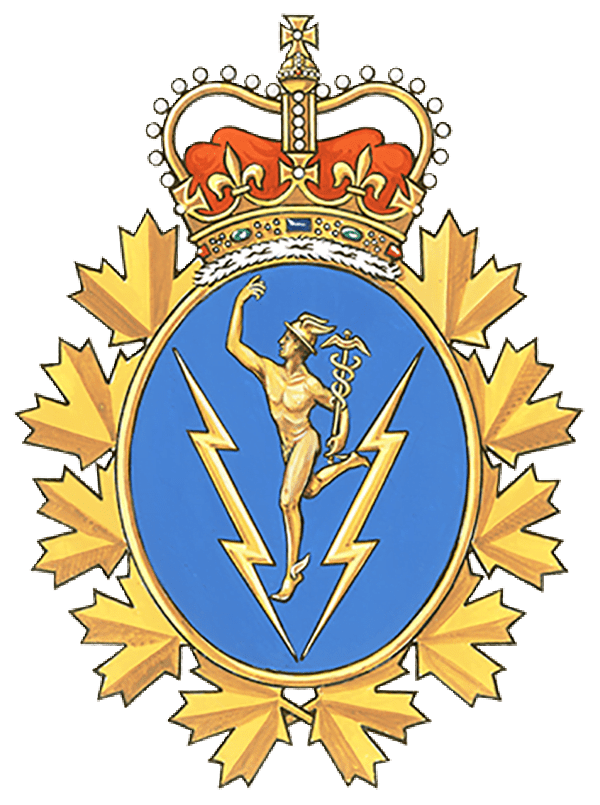1er octobre 1966
Marque l’anniversaire du
Profession de recherche en communication
58 ans d’excellence en SIGINT
1966 Intégration et unification
1er octobre 1966 – Un nouveau groupe professionnel militaire (GPM) 291, Recherche en communications (Comm Rsch), a été créé, intégrant le métier de spécialiste radio (RS) de la Marine royale canadienne (MRC), le Corps royal canadien des transmissions radio (RCCS) opérateur télégraphique ( R & TG) et l’opérateur des communications (Comm Op) de l’Aviation royale canadienne (ARC) en un seul groupe professionnel pour la conduite du renseignement d’origine électromagnétique (SIGINT).
19 Juillet 1966 – Intégration et l’unification, création du system radio supplémentaire des Forces Canadiennes (SRSFC). Station qui était préalablement sous contrôle indépendante, par le service triparti, était maintenant sous contrôle d’un Capitaine de corvette stationné au quartier-général au NCSM Gloucester.
1 octobre 1966 – Cours de développement professionnel (CDP) 291 (Chercheur en Communication) était créé. Les métiers d’opérateur radio spécial de la MRC et d’opérateur radio télégraphique (OR&T) respectivement de la Branche Royale canadienne des télécommunications et de la Branche Royale canadienne des Télécommunications de l’aviation, commencèrent leurs devoirs en tant que « 291 ».
Le 1er octobre est officiellement la date de création du métier de chercheur en communication.
Le Code des professions militaires (MOC) 291 (Recherche sur les communicateurs) est créé. Le métier de radioman spécial (RS) de la MRC, ainsi que les opérateurs radiotélégraphiques (R et TG) du Corps royal des transmissions canadiennes et l’opérateur des communications de l’Aviation royale canadienne (Opérations Comm) commencent leurs fonctions en tant que 291’ers.
Voici un peu de notre histoire menant à cet événement capital.
Et comme ils le font à la télévision – environ 12 semaines plus tôt :
11 juillet 1966 – Le CFSRS est autorisé en tant que formation à organisation intégrée. Les noms des stations ont été changés pour « Stations des Forces canadiennes » (CFS) et les OIC sont devenus des commandants. Trois stations sans fil de l’Armée canadienne (Alert, Ottawa et Ladner) et deux stations de l’ARC (Whitehorse et Flin Flon) se sont jointes au système. Un QG établi à la SFC Gloucester sous la direction d’un commandant de commandement, avec certaines limites. Le CFSRS est composé des personnes suivantes :
- QG SRFC, SFC Gloucester, Ottawa 2 Ont.
- CFS Bermudes, Daniels Head, Bermudes
- SFC Churchill, Churchill, Man
- SFC Coverdale, Moncton (N.-B.)
- SFC Flin Flon, Flin Flon, Man
- SFC Frobisher Bay, Frobisher Bay (T.N.-O.)
- SFC Gander, Gander, Terre-Neuve
- SFC Gloucester, Ottawa (Ontario)
- SFC Inuvik, Inuvik (T.N.-O.)
- SFC Ladner, Ladner (Colombie-Britannique)
- SFC Leitrim, Ottawa 2, Ont.
- SFC Masset, Masset, Colombie-Britannique
- SFC Whitehorse, Hillcrest, Yukon
- Remarque : Le cmdt CFSRS sera responsable devant le SCF pour C et C.
Les informations ci-dessous sont disponibles sur le lien fourni. Merci au Major Rob Marin (ancien Comm Rsch qui avait CFR au SIGS). http://www.rcsigs.ca/index.php/Cracking_the_Code
SIGINT de l’Armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale
Par le major Rob Martin
Collège militaire royal du Canada
Hiver 2004
L’une des valeurs suprêmes du renseignement électromagnétique est qu’il constitue un chemin court vers l’esprit des autres. On lit ce que dit réellement l’auteur et ce qu’il transmet aux autres pour ses propres besoins. L’expérience de la guerre a démontré que le renseignement sans fil est l’une des sources d’informations secrètes les plus importantes.[1]
– Général Charles Foulkes
En décembre 1945, le nouveau chef d’état-major général, le général Charles Foulkes, exprima ses vifs sentiments concernant la valeur du renseignement sans fil dans un mémorandum confidentiel adressé au gouvernement canadien intitulé « Une proposition pour la création d’une organisation nationale de renseignement ». [2 ] Essentiellement, ce travail, qui a contribué à l’élaboration d’un cadre pour le renseignement canadien au début de l’après-guerre, a servi de témoin des efforts de renseignement canadien – en particulier « sans fil » – des six dernières années. Le témoignage du général Foulkes était certainement sincère ; il avait été la cible de renseignements « sans fil » en tant que commandant de la 2e Division canadienne et du Premier Corps canadien dans le Nord-Ouest de l’Europe immédiatement avant et après l’invasion de la France en juin 1944. Mais le mémorandum ne fait pas grand-chose pour il met en lumière les efforts des diverses organisations canadiennes « Special Wireless » (S.W.) auxquelles il rend secrètement hommage, dont les soldats « ont servi en silence » au Canada et à l’étranger entre 1939 et 1946.[3] Bien qu’une quantité indéterminée d’informations concernant « S.W. » ou « Y » pendant la guerre restent hors du domaine public, il existe désormais suffisamment de documents disponibles pour fournir un aperçu substantiel de l’effort SIGINT de l’Armée canadienne pendant la Seconde Guerre mondiale : cet article est une tentative en ce sens.
Contexte
Le concept de collecte de renseignements à partir d’interceptions radio n’était pas nouveau pour l’Armée canadienne au début de la Seconde Guerre mondiale, même s’il n’était pas encore mis en pratique efficacement à l’époque. Au cours des dernières étapes de la Première Guerre mondiale, un petit nombre de soldats canadiens (des interprètes et des télégraphistes allemands) sur le front occidental étaient employés pour « intercepter et décoder les messages radio ennemis » à la mi-août 1917, « lorsqu’une station composée d’un syntoniseur MK III et d’un amplificateur à 3 tubes fut érigée dans le bois de Riaumont »[4] (le premier enregistrement d’interception de communications allemandes par le Corps canadien – principalement téléphoniques (non radio) – a eu lieu vers le 1er janvier 1917, au « poste no 6 », à Neuville St. Vaast).[5] À partir d’août 1917, les Canadiens, en soutien à un effort de collecte de données radio allié plus vaste, ont mené de telles interceptions contre les forces allemandes jusqu’au 21 août 1918 au moins, lorsqu’un site érigé à la hâte à Demuin a été fermé.[6] À la fin des hostilités, chaque compagnie de transmission divisionnaire était chargée de fournir des services qui comprenaient l’interception des communications militaires allemandes.[7] Les succès d’interception ont varié, de l’avertissement précoce d’une attaque allemande contre la colline 70, fourni le 15 mars 1918, qui a conduit à la défaite allemande, à ce que le lieutenant-colonel W. Arthur Steel du Corps royal canadien des transmissions considérait comme « peut-être la contribution la plus utile de ces stations [d’interception]… l’aide qu’elles ont apportée pour déterminer les unités composant les forces allemandes sur [le] front ». [8] Au moment de la démobilisation, cependant, les éléments d’interception radio naissants ont subi le même sort que de nombreux autres établissements du Corps expéditionnaire canadien (CEC) en temps de guerre – ils ont été radiés – et aucun effort n’a été fait pour créer ou maintenir une capacité organique de l’Armée canadienne en matière de renseignement sans fil, stratégique ou tactique, jusqu’au printemps 1938 [9] (l’interception sans fil a physiquement commencé au Canada en 1925, lorsque l’Amirauté britannique a demandé à la Marine canadienne de « construire [italiques de moi] une station de radio et de radiogoniométrie à Esquimalt… pour fonctionner avec une station similaire à Singapour » : la station était habitée [10] Au début de la Seconde Guerre mondiale, le brigadier-général Macklin, qui deviendra plus tard adjudant-général de l’armée, a résumé succinctement les capacités du Canada à mener des opérations de renseignement sans fil à l’appui de tout effort de guerre ainsi : « L’organisation du renseignement radio, la sécurité des signaux et le chiffrement des communications sans fil étaient vraiment en main au War Office lorsque la guerre a commencé – nous n’étions nulle part ». [11]
Canada
L’attaque de l’Allemagne contre la Pologne au début de septembre 1939 a servi de catalyseur à l’armée canadienne pour envisager et mettre rapidement en œuvre des capacités de collecte et d’analyse sans fil, aux niveaux stratégique et tactique. En octobre 1939, le noyau du premier site statique spécial de communication sans fil de l’armée était en train d’être formé à Ottawa, à la station de transmissions de l’armée à l’aéroport de Rockliffe. Comme l’a rappelé au milieu des années 1980 Bob Grant, un jeune signaleur de 19 ans qui commanda plus tard la 2e Section canadienne de radiocommunications spéciales de type B dans le nord-ouest de l’Europe en 1944-1945 :
Bill, Ray et moi avons été priés de nous présenter au major W.J. Megill, dans les bureaux de la direction des transmissions, dans l’immeuble Elgin. Il nous a informés que les transmissions de l’armée allaient lancer une nouvelle entreprise appelée « Y ». Il a déclaré : « Pour le moment, nous n’en savons rien, mais nous vous donnerons une pièce, du matériel radio et vous installerons au sous-sol de la station de transmissions de l’armée, avec un ENTRÉE RESTREINTE. Alors, allez-y et commencez. » [12] À partir de cette directive plutôt vague, la petite « unité expérimentale » a commencé presque immédiatement à intercepter les « lettres mélangées de messages chiffrés ». Comme il n’y avait pas d’expertise en cryptanalyse (comprendre la capacité de convertir un message chiffré en texte clair sans connaître l’algorithme de codage ou « clé ») au Canada à l’époque, le capitaine H.D.W. Wethey, le premier commandant de l’unité, a été rapidement envoyé en Grande-Bretagne pour déterminer ce qu’il fallait faire avec le matériel intercepté. [13] Sa visite de liaison était opportune pour les deux pays. On découvrit que, en raison de la propagation du signal ou « saut radio », la station canadienne captait des transmissions « illicites » entre des agents allemands opérant dans l’hémisphère occidental et leurs contrôleurs à Berlin qui n’étaient pas entendues par les sites d’interception britanniques. Une relation de travail coopérative entre les deux organisations s’est rapidement développée. De retour au Canada, l’armée a pris des dispositions avec la Marine royale canadienne (MRC) pour que ses « stations d’écoute », situées dans les Maritimes, fournissent des « lignes de relèvement » de radiogoniométrie sur les émetteurs cibles de l’armée, car l’unité de Rockliffe n’avait pas cette capacité.[14] La taille du site S.W. de Rockliffe s’est rapidement développée, en termes d’équipement, de capacité et de personnel. Au milieu de l’année 1941, pour répondre au besoin d’espace supplémentaire, un site d’interception permanent a été construit au sud de la ville à Leitrim, et la station spéciale sans fil n° 1 de Leitrim a été créée.[15] À cette époque, les opérateurs d’interception canadiens, désormais sous le commandement du capitaine Ed Drake (un « jeune homme sérieux avec un don pour tirer le meilleur parti de [ses] subordonnés »[16]), avaient accumulé un dossier substantiel sur « l’espionnage allemand dans l’hémisphère occidental » ; entre autres tâches, ils « suivaient les activités de quelque cinquante-deux agents ennemis » et « avaient réussi à lire 740 messages allemands »[17]. Comme le note l’historien Wesley Wark, c’est au cours de cette période que « le Canada a ainsi goûté pour la première fois aux fruits du renseignement sur les signaux »[18].
La croissance du service spécial de radiocommunication de l’armée au Canada a été complétée par un intérêt accru du gouvernement du Canada pour les dividendes de ce travail. Parallèlement à l’expansion du site de Rockliffe à Leitrim en 1941, une petite unité de cryptanalyse (l’« Unité d’examen ») a été créée dans une salle du Conseil national de recherches (CNR) sur le chemin de Montréal à Ottawa, sous la direction du ministère des Affaires extérieures[19]. En novembre 1940, le capitaine Drake eut des discussions à Washington avec le général Maughborne, chef des transmissions de l’armée américaine, qui recommanda la création immédiate au Canada d’un « Bureau d’analyse cryptographique » de l’armée, doté d’un effectif à long terme d’environ 200 personnes.[20] Maughborne estimait qu’« une telle unité pourrait produire [des informations] de la plus haute valeur pour un pays en guerre ». Le capitaine Drake recommanda par la suite au Comité des chefs d’état-major la création d’un Bureau de cryptographie doté d’un personnel conjoint (pour une efficacité du personnel), mais au début de décembre, sa proposition fut catégoriquement rejetée ; la duplication potentielle des efforts entre les Alliés et le coût élevé furent cités comme explications officielles.[21] Sans se laisser décourager par ce refus, Drake et son homologue de la Marine royale canadienne, le lieutenant C.H. Little a poursuivi la question à travers leurs chaînes de commandement et, relativement rapidement (au printemps 1941), le sujet a été porté à l’attention du Dr H.L. Keenleyside, des Affaires extérieures, qui a défendu la cause cryptanalytique pour le gouvernement.
L’unité d’examen canadienne, sous la direction du célèbre cryptanalyste américain Herbert Osborne Yardley, connu pour son infâme The American Black Chamber, commença ses opérations en juin 1941 avec un personnel interministériel très réduit de neuf personnes (des membres du NRC, de l’armée, de la Censure des câbles, du ministère des Postes et de la GRC étaient prêtés à l’unité).[22] Il est intéressant de noter que pour ne pas susciter la colère des organisations SIGINT américaines ou britanniques de l’époque, Yardley travailla au Canada sous le nom d’Herbert Osborne (il fut vilipendé et toujours très calomnié par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour avoir divulgué des secrets SIGINT dans son livre de 1931). L’emploi de Yardley fut finalement résilié au bout de six mois, une fois que les deux pays découvrirent qu’il travaillait pour la cause cryptanalytique canadienne et firent pression sur le Canada – sous la menace ouverte de rompre les relations SIGINT en pleine expansion – pour son renvoi. [23] C’est ainsi qu’au milieu de l’année 1941, l’unité d’examen contrôlée par les Affaires extérieures et l’armée canadienne ont commencé à collaborer étroitement. Outre le personnel de l’armée qui était détaché auprès des stations spéciales de radio de l’armée et, plus tard au cours de la guerre, des sites d’écoute de la MRC et de l’ARC, ils ont fourni le trafic intercepté – d’abord allemand « illicite », puis français de Vichy et japonais – à l’unité d’examen, qui a analysé (c’est-à-dire décrypté, traduit) le matériel et a ainsi pu fournir « un flux continu de renseignements au ministère des Affaires extérieures et aux directeurs du renseignement ». [24]
Les efforts de collecte de renseignements SIGINT de l’armée au Canada se sont rapidement développés avec l’entrée en guerre du Japon. À l’automne 1941, avant même l’attaque de Pearl Harbor le 7 décembre, l’armée avait commencé la construction d’une deuxième « station spéciale de radio » à Victoria, en Colombie-Britannique, pour permettre l’interception sans fil de la région du Pacifique. [25] Avant la fin de la guerre en août 1945, deux autres stations spéciales de radio de l’armée étaient – ou avaient été – en service, les deux sites étant également situés dans l’Ouest. La station spéciale de radio n° 2 a été établie dans une ancienne station forestière à environ un mile au nord-est de Grande Prairie, en Alberta, le 8 mai 1942, lorsqu’un officier et 17 autres soldats y sont arrivés par train.[26] Après plus d’un mois de construction et d’installation d’équipement, des opérations limitées sur le site ont commencé le 22 juin, après l’érection de « quatre mâts d’antenne en acier de 73 pieds » aux « coins de la propriété ».[27] Le quatrième site, la station spéciale de radio n° 4, a été brièvement établi dans la région de Chilkotin en Colombie-Britannique à Riske Creek au printemps 1944 dans un pavillon « construit par un riche Américain », mais a été fermé en juillet de la même année, peut-être en raison de difficultés de dotation en personnel.[28] Les journaux de guerre des stations spéciales de radiotélégraphie n° 1 et 2, tout en fournissant des descriptions quotidiennes précises de la météo locale et des activités sportives et sociales des unités, ne jettent que peu de lumière sur leur mission opérationnelle, et à juste titre. Comme l’admet une entrée précoce dans le journal de la station spéciale de radiotélégraphie n° 2, « [d]ans l’intérêt de la sécurité et en raison de la nature extrêmement secrète du travail… aucune information qui divulguerait la nature réelle du travail effectué » ne serait enregistrée.[29]
Chacune des stations spéciales de radio était administrativement subordonnée aux districts militaires dans lesquels elle résidait, mais était sous le contrôle opérationnel d’une « unité de discrimination » de l’armée à Ottawa, commandée par l’énergique capitaine Ed Drake. L’unité de discrimination, qui était initialement située au même endroit que l’unité d’examen sur l’avenue Laurier, était responsable de l’analyse du trafic – « une étude approfondie des détails du fonctionnement du système de signalisation de l’ennemi »[30] – du matériel brut provenant des sites d’interception avant son passage à l’unité d’examen et/ou aux agences partenaires britanniques et américaines (le British Radio Security Service ou Government Code and Cipher School, et la Signal Security Agency de l’armée américaine) pour décryptage. L’unité, également connue sous le nom de MI2, était une organisation coopérative du Signal and Intelligence Corps autorisée à l’automne 1940 qui, à son apogée en temps de guerre, employait plus de 100 personnes.[31]
Une conférence sur le renseignement radio, qui s’est tenue à Washington du 6 au 16 avril 1942, a marqué le début de la formalisation de la division géographique des efforts d’interception entre la Grande-Bretagne, le Canada et les États-Unis contre les puissances de l’Axe.[32] L’armée canadienne continuerait de fournir le trafic « illicite » allemand crypté à l’unité d’examen, qui diffuserait ensuite les produits de renseignement décryptés en langage clair à la Grande-Bretagne et aux États-Unis ; elle étendrait également la collecte pour inclure le trafic militaire, diplomatique et commercial japonais.[33] La conférence a jeté les bases d’une future coopération entre les trois partenaires, avec des accords substantiels conclus sur « la recherche sur les effets ionosphériques et le cryptage et le décryptage des transmissions non Morse » : comme le commente l’auteur John Bryden, « la coopération systématique entre les trois pays sur l’échange de renseignements sans fil… date de [cette] conférence. »[34] Une conférence ultérieure, tenue à Washington, D.C., en mars 1944 (« un véritable Who’s Who du renseignement spécial » – le capitaine Drake est le numéro 4 sur la photo ; William Friedman, considéré comme le « père » de la cryptanalyse américaine, est le numéro 1), a affiné davantage la division des efforts des services spéciaux sans fil alliés et a accru la visibilité de l’unité canadienne de discrimination parmi les Alliés en l’associant pleinement – bien qu’en tant que partenaire « junior » – à la Signal Security Agency américaine : « À partir de maintenant jusqu’à la fin de la guerre, le travail [de l’unité de discrimination]… à Ottawa est devenu une sorte de succursale américaine. opération. Arlington a défini les tâches, distribué le matériel brut et reçu les résultats. »[35]
Les opérations de radiotélégraphie spéciale au Canada étaient passées de pratiquement rien en 1939 à un statut de partenaire junior SIGINT auprès des Alliés en 1944. Des centaines d’hommes et de femmes employés au sein du système de radiotélégraphie spéciale de l’armée, qu’il s’agisse d’opérateurs du Signal Corps ou d’analystes et de linguistes du Corps du renseignement, ont grandement contribué à ce succès. Mais leur contribution n’était pas la seule contribution de l’armée au SIGINT fournie par le Canada pendant la guerre – les unités tactiques de radiotélégraphie spéciale de l’armée canadienne ont également joué leur rôle.
Europe
Les soldats de l’armée canadienne ne se sont pas limités à l’interception et à l’analyse des signaux radio statiques au Canada pendant la Seconde Guerre mondiale. Aussi importante que soit la mission statique pour la cause stratégique plus large des Alliés, les unités tactiques canadiennes de « radiocommunications spéciales » ont joué un rôle tout aussi important auprès de leurs commandants opérationnels, qu’ils soient britanniques ou canadiens. Presque parallèlement à la création et au développement de la première station de radiocommunication spéciale de l’armée à Ottawa, des sections de radiocommunications spéciales ont été mobilisées pour servir dans des opérations tactiques. Les discussions visant à former de telles unités canadiennes ont commencé au Quartier général militaire canadien (Q.M.C.) à Londres en mai 1940, et la première unité de campagne de « radiocommunication spéciale » – « Section de radiocommunication spéciale de type « B » R.C. Sigs. (A.F.) », sous le commandement du lieutenant J.W. Anderson[36] – a été créée à Ottawa le 5 décembre 1940.[37] Organisé « UNIQUEMENT POUR DES TÂCHES DE RENSEIGNEMENT et NON pour surveiller notre propre trafic sans fil »[38], le Canada a déployé un total de cinq unités spéciales de radiotélégraphie de l’armée (une de type « A », deux de type « B », une de type « C » de courte durée et un groupe spécial de radiotélégraphie) qui ont servi en Italie, dans le nord-ouest de l’Europe et dans le théâtre du Pacifique jusqu’en 1945.
Il est compréhensible que chacun des éléments de radiotélégraphie ait des structures similaires, avec une section spéciale de radiotélégraphie (composantes d’interception, de recherche de direction et de soutien au service) et une section de renseignement sans fil (linguistes, analystes) se combinant pour former l’unité. Le commandement général était confié à un officier du Corps royal canadien des transmissions, qui était responsable de l’administration, de la discipline, du soutien aux communications et des déplacements de l’unité. L’officier commandant la section de renseignement sans fil « contrôlait et assignait la couverture de fréquence des différentes radios dans les fourgons et les tâches de radiogoniométrie (DF).[39] Cette anomalie de la chaîne de commandement a créé une certaine tension pendant la période de formation des unités – en fait jusqu’à la mi-1943 – comme le note Elliot dans Scarlet to Green :
Les hommes [du renseignement] se plaignaient du manque d’intérêt et de compréhension de leur rôle par le commandant de leur unité de transmissions, du fait qu’ils ne recevaient pas de salaire de métier et que leur administration générale était médiocre. Leur mécontentement provenait en grande partie de la question plus large de savoir à qui appartenait réellement la section. L’officier des transmissions du corps considérait que la section faisait partie de son organisation. . . Selon lui, il s’agissait de personnel des transmissions effectuant des tâches de renseignement, plutôt que de personnel du renseignement attaché à une unité de transmissions pour des raisons administratives et opérationnelles.[40]
Le brigadier Foulkes, BGS de la Première armée canadienne, a finalement rectifié ce débat en cours dans sa Directive no 4 du renseignement de la Première armée canadienne, publiée le 10 juin 1943. Visiblement conscient de la discorde au sein des unités spéciales de radiotélégraphie, il a déclaré avec force : « Il est essentiel que toutes les sections spéciales de radiotélégraphie et de renseignement sans fil se considèrent comme UNE UNITÉ et travaillent en parfaite coordination et en communauté d’intérêts dans un seul but : PRODUIRE DU RENSEIGNEMENT. »[41]
Le 19 août 1942, trois unités spéciales de radiotélégraphie de l’armée avaient été mobilisées au Canada et se trouvaient maintenant en Angleterre à divers stades d’embarquement, d’entraînement ou d’opérations de collecte.[42] La première à arriver, la section spéciale de radiotélégraphie no 1 de type « B » – une unité de niveau Corps – menait des opérations d’interception et de radiogoniométrie 24 heures sur 24, en étroite coopération avec les unités d’interception « sœurs » britanniques, contre des cibles militaires allemandes depuis Bolney, à environ 12 kilomètres au nord de Brighton, sur la côte sud de l’Angleterre. Depuis leur arrivée en octobre 1941, les soldats de l’unité avaient reçu environ quatre semaines de formation spécialisée, y compris des conférences « sur les procédures allemandes et italiennes, les méthodes utilisées pour détecter les postes de contrôle des filets, etc. », du bataillon britannique d’entraînement des opérateurs spéciaux (S.O.T.B.) à Trowbridge, dans le Wiltshire, et étaient opérationnels depuis fin décembre.[43] Il convient de noter que le jour même de l’arrivée de la section spéciale de radiotélégraphie n° 2 en Angleterre, l’unité « a aidé l’opération [à Dieppe] en relayant des informations des Allemands au Corps [canadien] pour les aider à suivre ce que faisaient les Allemands et les informations qu’ils avaient sur les troupes canadiennes. »[44] La section spéciale de radiotélégraphie n° 1 de type « B » a poursuivi ses opérations d’interception dans le sud de l’Angleterre jusqu’à son déploiement en Italie avec le quartier général du 1er Corps canadien au début de janvier 1944, où elle a servi jusqu’en mars 1945.
C’est alors qu’il se trouvait en Italie, au plus fort de la bataille de la vallée du Liri, que le signaleur Ed Marten « intercepta un message de la division [Panzer] Herman Goering indiquant qu’elle était en mouvement » en réponse à l’offensive alliée de la fin mai. Cette information essentielle, immédiatement reconnue pour sa valeur et rapidement transmise par la chaîne de renseignement, permit une concentration de « tous les chasseurs et chasseurs-bombardiers disponibles » pour attaquer la force de contre-attaque allemande, « causant des pertes considérables ».[45] La Section spéciale de radiotélégraphie de type « B » n° 1 avança vers le nord à travers l’Italie avec le Corps canadien jusqu’à Ravenne, où, au début de mars 1945, elle reçut l’ordre de « rendre tout son équipement » et de rejoindre les autres Sections spéciales de radiotélégraphie qui soutenaient alors la Première armée canadienne dans le nord-ouest de l’Europe.[46]
La Section spéciale de radiotélégraphie de type « C » n° 1, sous le commandement du lieutenant G.A. Cooper, formée dans des circonstances douteuses à Ottawa à la fin de juin 1941.[47] La petite unité, avec un effectif maximum de 23 hommes de tous grades, dont un officier, a vécu, s’est entraînée et a été déployée en Angleterre avec la section spéciale de radio de type B n° 1, mais il ressort clairement du journal de guerre de l’unité qu’elle a éprouvé des difficultés à acquérir du personnel et de l’équipement dès le début. Une fois en Angleterre, l’unité n’a pas reçu de formation S.O.T.B., comme l’a fait la section de type B, et ne s’est pas déployée sur la côte sud de l’Angleterre pour mener une quelconque mission opérationnelle. Malgré ces facteurs, cependant, d’octobre 1941 jusqu’à ce que l’unité soit « réduite à zéro » fin mars 1942 sur ordre du colonel Genet, chef des transmissions du Corps (C.S.O.), le lieutenant Cooper et ses hommes ont travaillé avec ténacité pour se maintenir et générer une capacité de mission.[48]
Il est intéressant de noter qu’au début de mars 1942, l’unité canadienne de renforts de signaux (C.S.R.U.) a employé avec succès la section spéciale de radiotéléphonie de type C n° 1 comme élément de surveillance ad hoc des « forces amies ». Très rapidement, les soldats de l’unité ont intercepté des violations de la sécurité des communications et des opérations, notamment deux opérateurs anglais non identifiés qui « ont mentionné clairement plusieurs noms de lieux ainsi que des noms d’officiers jusqu’au grade de colonel, et ont décrit en détail un plan de défense de zone dont ils faisaient partie, en indiquant l’emplacement des QG et d’autres informations de sécurité ». [49] L’incident a été signalé au commandant de la C.S.R.U. le 16 mars : à peine 8 jours plus tard, la section spéciale de radiotéléphonie de type C n° 1 a effectivement cessé d’exister. Comme l’a déclaré le commandant frustré, caustiquement noté, “depuis que cette unité a été organisée, il y a eu un doute dans l’esprit du War Office quant à savoir si cette unité était vraiment nécessaire”[50]: il semble qu’à la fin de mars 1942, peut-être en raison de son récent succès de surveillance, elle ne l’était pas! La section spéciale de radiotélégraphie n° 1 de type « C » est restée dans l’effectif de guerre, bien que sans effectif, jusqu’au 1er avril 1943, date à laquelle elle a été officiellement dissoute.
La section spéciale de radiotélégraphie n° 2 de type « B », mobilisée à Kingston le 5 mai 1942 avec un effectif de temps de guerre de 2 officiers et 68 autres grades, était début août en route vers l’Angleterre à bord du transport de Sa Majesté Cameronia. [51] Après avoir terminé les routines administratives initiales au C.S.R.U. à Farnborough, l’unité a rejoint sa section « sœur » canadienne (n° 1) à Bolney début septembre. Les moments forts de son séjour en Angleterre furent la participation du personnel au cours de formation « Y » de la S.O.T.B., désormais élargi, d’une durée de deux mois, à Trowbridge, ainsi que l’interception opérationnelle et la recherche de direction contre des cibles de l’armée allemande à partir de divers endroits de la côte sud. Au printemps 1943, le capitaine Bill Grant, premier commandant de l’unité, fut envoyé en Afrique du Nord avec la Première armée britannique pour acquérir de l’expérience sur le champ de bataille « Y » (le commandement fut transmis à son frère, le capitaine Bob Grant).[52] À son retour d’Afrique du Nord, il fut nommé G.S.O.3(I(s)) de la Première armée canadienne et devint ainsi, en coopération avec un petit cadre du renseignement au QG de l’armée, responsable de toutes les questions « Y » au sein de l’armée canadienne.
Avant le départ pour l’Italie de la Section spéciale de radiotélégraphie de type « B » n° 1 en janvier 1944, il y avait trois sections spéciales de radiotélégraphie canadiennes actives en Angleterre qui menaient des opérations d’interception en temps réel contre des cibles militaires allemandes. La Section spéciale de radiotélégraphie de type « A » n° 3, avec le capitaine J.W. Anderson comme commandant en chef et le lieutenant G.A. Cooper comme commandant en second, a été formée en Angleterre en juin 1943 pour fournir « une interception générale qui fournit des renseignements radio pour le renseignement de l’état-major général au QG de l’armée et des informations « Y » de valeur pour d’autres unités « Y » ».[53] Les soldats ont suivi une formation d’opérateurs spéciaux de l’armée britannique, mais pas à Trowbridge ; la Section n° 3 a reçu sa formation spéciale de radiotélégraphie du S.O.T.B. à Douglas, sur l’île de Man.[54] L’unité a commencé des opérations d’interception limitées en novembre 1943 et, en décembre, les trois sections canadiennes de radiotélégraphie spéciale étaient intégrées au réseau de collecte de radiotélégraphie spéciale du 21e groupe d’armées, dispersées tactiquement le long de la côte sud de l’Angleterre[55] : la section S.W. n° 1 de type « B » était située à Eastbourne, dans l’East Sussex ; la section S.W. n° 2 de type « B » était située à Angmering-on-Sea, dans le West Sussex ; et la section S.W. n° 3 de type « A » était située à Rottingdean, dans le West Sussex. Toutes les sections de radiotélégraphie spéciale du 21e groupe d’armées étaient reliées par téléphone et sans fil. Les cavaliers d’expédition (D.R.) collectaient quotidiennement le matériel d’interception de chaque unité – parfois jusqu’à quatre fois par jour – afin de le transporter à Londres pour une analyse/un décryptage plus approfondi (ce matériel était simultanément fourni par la chaîne de commandement au QG du Corps et de l’Armée). En décembre 1943, les sections spéciales de radiotélégraphie canadiennes interceptaient, analysaient et fournissaient activement des informations sur l’ordre de bataille (O.O.B.) des unités allemandes en France auxquelles elles et l’armée canadienne seraient confrontées en 1944.
Le 6 juin 1944, la section spéciale de radiotélégraphie de type « B » n° 2 poursuivait sa mission d’interception et de radiogoniométrie depuis Pett Level, dans le Sussex, tandis que la section spéciale de radiotélégraphie de type « B » n° 3 était non opérationnelle à Rustington, entièrement emballée et chargée pour son transfert en France.[56] Les deux unités étaient sur le continent européen pour soutenir leur corps et leur quartier général d’armée le 17 juillet : la section n° 2 de Cairon et la section n° 3 d’Amblie, à environ 15 kilomètres de distance. Les sites d’interception des sections étaient situés à l’arrière de la zone de bataille, près de leurs quartiers généraux respectifs, tandis que leurs détachements de radiogoniométrie étaient dispersés bien en avant, près des unités de l’échelon de combat. [57] Les premiers succès d’interception furent fréquents, comme les exploits de la Section spéciale de radiotélégraphie de type B contre le 21e Régiment de reconnaissance blindé, les « yeux du général Rommel » : il s’agissait d’une unité de véhicules blindés allemands qui… s’était déployée sur tout son front. Leurs communications dépassaient tous les échelons de communication normaux pour lui rendre compte directement de l’état de la bataille. Ils utilisaient un code TL. Nous pouvions identifier l’unité immédiatement et lire le code. Nous avions l’impression de transmettre les messages allemands au quartier général du 2e Corps canadien plus rapidement que les Allemands à Rommel.[58] Les deux unités spéciales de radiotélégraphie appuyèrent toutes les opérations de la Première Armée canadienne en France et en Belgique au cours de l’été et de l’automne 1944. De plus, des détachements spéciaux composites, comprenant des soldats des S.W. canadiens et britanniques, Français Les sections S.O. du 21e Groupe d’armées étaient fréquemment formées et assignées à des missions d’interception spécifiques le long du front en progression (il ressort clairement des journaux de guerre des sections S.O. n° 2 et 3 que les transmissions radio à très haute fréquence (V.H.F.) à courte portée « en ligne de vue », émanant des unités d’élite allemandes, étaient des cibles prioritaires, bien que le succès initial contre ces éléments ait été limité).[59] En décembre 1944, les sections S.O. n° 2 et 3 étaient opérationnellement statiques dans les Pays-Bas, déployées sur le front de la Première armée canadienne en Hollande, orientées vers l’est, de Wijchen (environ 10 kilomètres au sud-ouest de Nimègue – section S.O. n° 2) au nord, à Tilburg (section S.O. n° 3) au sud. Également au cours de ce mois, le major Bowes, commandant en chef de la section S.O. n° 1 La section, actuellement en Italie, a effectué une première reconnaissance dans la région en prévision du retour de son unité dans la Première Armée canadienne au printemps 1945.
Au cours de l’hiver et du printemps 1945, les sections canadiennes du S.W. suivirent à la lettre les directives du renseignement du général Foulkes de juin 1943, en fournissant à la fois « l’interception avancée de matériel stratégique pour la recherche au GHQ » et « la fourniture d’informations d’intérêt direct au corps »[60] : elles participèrent aux opérations VERITABLE (en soutien au 30 Corps britannique), BLOCKBUSTER et PLUNDER. Au cours de l’opération VERITABLE, elles connurent des succès contre la 3e division Panzer Grenadier, le 20e régiment de parachutistes de la 7e division de parachutistes et la 116e division Panzer.[61] Le 9 mars (OP BLOCKBUSTER), les Canadiens interceptèrent et signalèrent le trafic allemand en langage clair qui indiquait l’évacuation des unités d’artillerie allemandes se retirant vers l’est de l’autre côté du Rhin dans la région de Wesel : « ce message extraordinaire spécifiait les unités et donnait le nombre total de canons encore en tête de pont. »[62] Lors de l’OP PLUNDER, la radio spéciale canadienne a fourni des renseignements précis sur les dispositions, principalement à partir d’interceptions en langage clair, de « 6, 7, 8 PARA DIVS et de la 116 Pz Div Recce. »[63] Au cours de cette période d’environ deux mois, F.H. Hinsley, rédacteur en chef de British Intelligence in the Second World War, volume 3, note : « Y a connu un renouveau marqué. Les liaisons VHF, en particulier celles des divisions de parachutistes, ont fourni un flux constant d’informations, principalement en langage clair, aux unités Sigint avancées. »[64] Les trois sections canadiennes de radio spéciale ont été réunies à la fin de mars 1945 lorsque le 1er Corps canadien (y compris la section no 1 S.W. Type Les sections « B ») se joignirent à la Première armée canadienne. À la fin des hostilités, le 8 mai, les sections étaient situées comme suit : la section S.O. no 1 se trouvait en Hollande, dans la région d’Apeldoorn; les sections S.O. no 2 et 3 se trouvaient en Allemagne, dans les régions de Bad Zwifchenahn et de Meppen respectivement. Les unités continuèrent à surveiller les fréquences ennemies après le 8 mai pour s’assurer que les Allemands se conformaient à la reddition, tout en planifiant en même temps le rapatriement éventuel de leurs soldats au Canada.
Aucun soldat canadien du Service spécial de radiotélégraphie n’a été tué par l’ennemi dans le nord-ouest de l’Europe (un petit nombre est mort d’accident ou de maladie), cependant, il y a eu d’innombrables incidents évités de justesse alors que les unités se déplaçaient avec la Première armée canadienne en France, en Belgique, en Hollande et en Allemagne à l’automne 1944 et au printemps 1945. La plupart impliquaient des activités de reconnaissance d’unité, comme la fois où « le Capitaine Grant GSO III (Is) et le Cpl Patenaude ont eu une petite frayeur… lorsqu’ils se sont promenés à quelques centaines de mètres devant le site du Détachement n° 2 [DF] et ont tiré une demi-douzaine d’obus de 88 mm [sic] de Jerry »[65]; mais il y a eu d’autres occasions, y compris, mais sans s’y limiter, un « détachement VHF recevant un coup de près par des bombardiers américains »[66] et des bombes volantes (V1, V2) atterrissant très près des cantonnements de la Section S.O. n° 3 lorsque l’unité était située à Anvers[67].
Le Pacifique
Alors que les sections canadiennes de radiotélégraphie spéciale traversaient la France et les Pays-Bas à l’été et à l’automne 1944, une nouvelle unité de S.W. beaucoup plus importante était en cours de formation au Canada pour servir en Extrême-Orient. En mai de cette année-là, le commandant en chef de l’armée indienne a demandé au Canada de « fournir une unité spéciale de transmissions et de renseignement… pour intercepter les transmissions de Tokyo qui ne pouvaient pas être entendues au Canada ». [68] Le ministre de la Défense a approuvé l’autorisation de formation d’une telle unité, le Groupe spécial de radiotélégraphie n° 1[69], le 19 juillet ; cependant, en raison de pénuries de main-d’œuvre persistantes, la mobilisation a été lente. L’intention initiale du Canada était d’envoyer une première ébauche de soldats du Groupe S.W. en Inde avant le 1er octobre, la deuxième ébauche partant environ deux mois plus tard – en réalité, l’unité n’a pas été déployée avant la mi-janvier 1945, et à ce moment-là, sa destination avait été modifiée de l’Inde à l’Australie. [70]
Les soldats étaient recrutés parmi les effectifs disponibles des districts militaires (D.M.) de tout le Canada, et comprenaient des volontaires de chacune des stations spéciales de radiotélégraphie. Les spécialistes du renseignement étaient recrutés dans la première « école de langue japonaise de l’armée à Vancouver ». [71] La formation se déroulait à Ottawa et dans des endroits secrets de l’île de Vancouver, à l’extérieur de Victoria – Patricia (« Pat ») Bay et Gordon Head.[72] La fonction de l’opérateur d’interception était de copier le « code kana » militaire, une adaptation japonaise du code morse, tandis que la section du renseignement se chargeait de la traduction et de l’analyse.[73] L’unité était commandée par le lieutenant-colonel H.D.W. Wethey, premier officier commandant du petit élément de radio spéciale créé à Rockliffe en 1939.
Après près d’un mois en mer à bord de navires de transport américains, l’unité entière débarqua à Brisbane le 16 février 1945 et passa les deux mois suivants à coordonner les problèmes avec leurs homologues australiens et américains « Y » du « Camp Chermside », un camp militaire animé de 400 acres à la périphérie de la ville.[74] C’est à cette époque qu’une décision fut prise d’installer le « Groupe » à Darwin – sur la côte nord de l’Australie – pour travailler de concert avec d’autres unités « Y » alliées dans cette région, et des plans furent élaborés pour le déménagement. Sur le plan opérationnel, les Canadiens seraient responsables devant le « Bureau central » conjoint australo-américain, le centre de renseignement des signaux du général Douglas MacArthur dans le Pacifique. Le déplacement de l’unité vers le nord s’est déroulé par transport ferroviaire et routier sur une période de deux semaines début avril, et à la mi-mai 1945, le site, construit sur un « marais » récupéré sur MacMillan Road, était opérationnel, avec des opérateurs occupant 13 positions d’interception 24 heures sur 24.[75]
Le Groupe spécial de radiotélégraphie no 1 canadien a contribué de manière considérable à l’effort de renseignement SIGINT allié en Australie en interceptant une quantité considérable de matériel. Moins d’un mois après le début des opérations à plein temps, les Canadiens étaient responsables d’environ 22 % de tous les messages interceptés par les 12 sites alliés (4 américains, 7 australiens, 1 canadien) sur le continent.[76] Le personnel de la section du renseignement, reconnu pour ses solides compétences en japonais, était fréquemment sollicité par d’autres unités ; à la fin du mois de juillet, neuf personnes sous la direction du capitaine Woodsworth travaillaient pour un détachement du Bureau central à Manille, aux Philippines, et une autre – le sergent Olmstead – était à San Miguel.[77]
Sans surprise, et de manière très canadienne, le site de MacMillan Road a fait plus que mener des opérations d’interception contre des cibles militaires japonaises. Très rapidement, grâce à des initiatives à tous les niveaux de commandement, le camp est devenu une ruche d’activité sociale pour le personnel australien et américain travaillant dans la région. Un cinéma en plein air à grand écran construit rapidement, où des films tels que « Objective Burma » d’Errol Flynn étaient projetés trois fois par semaine – avec l’aimable autorisation du « U.S. Signal Corps » – attirait des foules de plus de 2 000 personnes ![78] Une ligue de baseball interarmées fut organisée ; une « chorale » de soldats canadiens se divertissait régulièrement, souvent accompagnée par « l’orchestre » de l’unité ; des danses canadiennes devinrent des événements auxquels il fallait assister, et un « club de presse » – The Static Press – fournissait des articles hebdomadaires intéressants.[79] En très peu de temps, les Canadiens contribuèrent certainement au moral des troupes sur la côte nord de l’Australie et eurent un impact positif sur celui-ci.
Après la capitulation du Japon à la mi-août, le 1er groupe S.W. canadien commença à préparer son retour au pays. Des retards administratifs et logistiques affligèrent l’unité tout au long de l’automne, et elle resta en Australie jusqu’en février 1946, lorsque ses soldats embarquèrent finalement sur un navire de transport de troupes pour leur retour au Canada. Bien que la patience des soldats pour rentrer chez eux ait souvent été mise à l’épreuve, leurs efforts ultimes ont été reconnus par le lieutenant-colonel Wethey, comme il l’a fait remarquer dans le livret souvenir de l’unité :
Malgré la période relativement courte d’existence de l’unité, beaucoup de choses ont été accomplies. Non seulement le rôle opérationnel de l’unité a été rempli d’une manière qui a reçu la reconnaissance qui lui est due, mais votre industrie et votre persévérance dans la poursuite de tâches qui ne sont normalement pas requises d’une unité comme la nôtre nous ont permis de jouer notre rôle dans la défaite du Japon beaucoup plus tôt que prévu.[80]
Avant leur libération de l’armée, cependant, les soldats du 1er Groupe spécial canadien de radiotélégraphie se sont une fois de plus vu rappeler « leur serment de secret – de ne jamais révéler leurs fonctions en temps de guerre. Pas même à leur famille. »[81]
Conclusion
Pendant plus de 40 ans, les soldats du 1er Groupe S.W. ont suivi à la lettre la dernière directive qu’ils ont reçue de leur chaîne de commandement : ne révéler à personne leurs activités en temps de guerre. C’est ce qu’ont fait leurs camarades soldats de la « Special Wireless » qui ont servi au Canada et en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale. Le succès de leur silence est attesté par le manque d’informations sur leurs activités dans les histoires des deux organisations de l’armée canadienne qui ont fourni le personnel – History of the Royal Canadian Corps of Signals 1903-1961, édité par John S. Moir, et Scarlet to Green: A History of Intelligence in the Canadian Army 1903-1963, du major Stuart Elliot. Le premier ouvrage contient moins d’un paragraphe d’informations sur la « Special Wireless » dans tout le volume ; le second, bien qu’il fournisse plus de détails, est encore assez clairsemé sur le sujet.
Le dévouement inlassable à la mission, l’ingéniosité de l’unité et des individus, la reconnaissance par les soldats de la valeur de leur travail pour sauver des vies canadiennes tout en aidant à vaincre l’ennemi, et la compréhension de la nécessité absolue de protéger le secret de leurs opérations caractérisent les opérations de la SIGINT canadienne au Canada, en Europe et dans le théâtre du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Le major Bowes, O.C. No. 1 Special Wireless Section Type « B », résume peut-être le mieux les efforts canadiens de SIGINT pendant la guerre lorsqu’il écrit, au retour de son unité d’Italie en mars 1945 : « Même si nos réalisations et nos succès n’ont pas été et ne seront jamais portés à l’attention du public, comme l’ont été les brillants exploits de nos frères d’armes qui servent dans les régiments traditionnels du Canada, nous avons la satisfaction de savoir que nos efforts ont grandement contribué à provoquer la chute de la puissance militaire la plus impitoyable que le monde ait jamais connue. »[82]
Le fait que les Forces canadiennes continuent de disposer d’une organisation « SIGINT » florissante au XXIe siècle est un hommage aux efforts d’hommes comme le lieutenant-colonel Ed Drake et les capitaines Bill et Bob Grant, ainsi qu’aux centaines d’hommes et de femmes qui ont servi leur pays dans le cadre de la « radio spéciale » pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faut en dire davantage sur ce sujet.